1. ETIOPATHOGENIE : RAPPELS FONDAMENTAUX
Le processus carieux appartient à la pathologie infectieuse
de l’enfant de façon quasi permanente et parfois de
façon préoccupante. La carie est une maladie dont le
symptôme est constitué par une déminéralisation des tissus
durs, conséquence de la fermentation acide des sucres par
les bactéries ; cet évènement ne se produit que lors
d’un contact étroit et prolongé bactéries/émail.
Selon la part d’intervention de chacun des facteurs,
le développement de la lésion carieuse est plus ou moins
rapide et plus ou moins important.
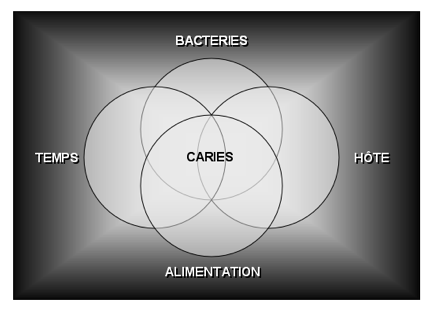
1.1. L’ HOTE : un facteur intrinsèque
La cavité buccale est un milieu très complexe offrant
différentes niches écologiques, riche en réactions
biophysiques et biochimiques qui vont influencer la qualité
de l’émail et de la salive le recouvrant.
La dent est la plupart du temps recouverte par un film
amicrobien de 0,1 à 1, la pellicule acquise, qui résulte de
l’adsorption de glycoprotéines dérivées de la salive
et du fluide gingival. L’adhérence des bactéries à
l’émail se produit généralement par
l’intermédiaire de cette pellicule acquise.
Les composants salivaires ont une importance fondamentale
dans l’écologie microbienne quant aux rapports
bactéries-surfaces orales. Leur rôle est double : ils
favorisent la colonisation des dents par différentes
bactéries et par ailleurs, ils retardent la formation de la
plaque ou même inhibent l’adhérence bactérienne.
Comme tout liquide biologique, la salive présente une
composition et un rôle complexes mais il est possible de
penser que sa finalité est de tendre vers un équilibre et
de se comporter comme une solution minéralisante.
1.1.1. La dent temporaire
Du fait de son anatomie et de
sa physiologie, la dent temporaire est particulièrement
susceptible à la carie. Des contraintes anatomiques et
physiologiques découlent les formes cliniques et par
là-même, les thérapeutiques.
La couronne est globuleuse avec un étranglement cervical.
Cette morphologie particulière favorise, en cas de lésions
carieuses proximales, les lésions septales interdentaires
et complique la prise au davier. Les sillons de la face
occlusale sont très marqués au niveau des molaires lors de
leur éruption, c’est-à-dire lors de
l’installation de la flore buccale (physiologique et
pathologique), puis les surfaces s’abrasent par la
suite.
- L’EMAIL : mince, peu minéralisé, dont les
prismes sont peu coalescents et mal orientés
- La DENTINE : mince, tendre, le diamètre des tubuli
est important, favorisant la pénétration bactérienne.
- La PULPE :
volumineuse
- Le CEMENT : peu épais et poreux.
Pendant son évolution, la dent temporaire passe par
différents stades déterminant des modifications pulpaires
qui vont conditionner sa réaction aux différentes
agressions.
- Au cours de la période de formation et d’éruption
(stade 1), la pulpe possède un grand potentiel réparateur
dentinogène.
- Au cours de la période de stabilité (stade 2), les
réactions de la pulpe sont comparables à celle de la
denture définitive. Néanmoins, la pulpe se caractérise par
une susceptibilité particulière à l’inflammation sur
un mode dégénératif.
- Au cours de la phase de résorption (stade 3), la dent et
le parodonte subissent d’importantes modifications
relatives à la migration apicale de l’attache
épithéliale, à la présence des canaux pulpo-parodontaux, à
la porosité du plancher pulpaire.
1.1.2. La dent définitive
jeune
Elle arrive souvent dans un
environnement défavorable.
-
Son émail est immature puisqu’il est minéralisé
seulement à 75% à l’éruption ; il mettra 1 an et
demi pour atteindre les 96% de minéralisation.
- Les sillons anfractueux et plus fragiles (zones de
coalescence) constituent des pièges à plaque.
- S’il s’agit de la 1° molaire, sa difficulté
d’accès et sa confusion relativement fréquente avec
une dent temporaire favorisent la permanence de la plaque
bactérienne.
- Les dents définitives font leur éruption dans une cavité
buccale où une flore plus ou moins
pathogène (selon l’indice carieux des dents
temporaires) s’est installée.
1.1.3.
Facteurs de l’écosystème
buccal
Différents
facteurs peuvent prédisposer à l’apparition de
lésions carieuses :
- héréditaires : qualité de l’émail (les dysplasies
prédisposent au processus carieux)
- congénitaux : troubles de l’odontogénèse, carences
vitaminiques (vitamine A)
- pathologiques : infectieux ( rougeole ), maladies
systémiques de la petite enfance
- locaux : salivaires d’une part : pH, concentration
en lysozyme et IgA secrétoires
dentaires et d’autre part : malpositions,
malocclusions.
1.2.
LES BACTERIES : un facteur extrinsèque
PERMANENT
Bien
que d’ordre acquis, les bactéries font partie
intégrante de l’individu en raison d’une
symbiose opportuniste.
Généralement aseptique à la naissance, la cavité buccale du
nouveau-né est rapidement colonisée dès la 6° heure. Les
bactéries cariogènes (Streptococcus
mutans et lactobacilles) ne sont
isolées que plusieurs semaines après les premières
éruptions dentaires.
La rencontre bactéries/surface amélaire s’effectue
par des interactions spécifiques entre la pellicule acquise
et les bactéries pionnières (généralement
Streptococcus
sanguis). La pellicule acquise est
l’intermédiaire obligatoire pour initialiser la
plaque bactérienne ; sa composition en glycoprotéines va
déterminer l’attachement initial de la 1° bactérie
colonisatrice.
La production bactérienne de
polysaccharides extra-cellulaires facilite
l’implantation successionnelle de différents
micro-organismes pouvant proliférer sous forme de
micro-colonies disposées en couches parallèles à la surface
dentaire et/ou sous forme de colonnes bactériennes
perpendiculaires à cette même surface.
Les bactéries
cariogènes vont utiliser, comme source nutritionnelle et
énergétique, les sucres extrinsèques dont le métabolisme
aboutit à la production d’acide lactique
déminéralisant l’émail ainsi qu’à la
fabrication de polysaccharides extracellulaires et
intracellulaires.
Les
polysaccharides extracellulaires
- empêchent la dilution de la
plaque,
- isolent la plaque des réactions physico-chimiques
buccales (tampons salivaires),
assurent le collage des
micro-organismes entre eux et aux surfaces, et enfin,
constituent une réserve d’énergie et de nutriments.
Les
polysaccharides intracellulaires servent de nutriments lors
d’un appauvrissement du milieu.
S’il
existe des plaques sans carie, il n’y a pas de carie
sans plaque :
La
capacité des micro-organismes à déclencher une lésion
carieuse est en rapport avec :
leur
nombre,
le pH le plus bas auquel ils fermentent les sucres,
l’importance de leur production acide à des pH
divers.
La production acide dans la plaque est conditionnée par :
la
rapidité de diffusion du sucre au sein de la plaque,
la vitesse de baisse du pH,
la lenteur de remontée du pH à sa valeur initiale.
Le pH auquel
la salive est saturée envers l’hydroxyapatite est
appelé pH critique et se situe entre 5,2 et 5,5.
La
stabilité de l’hydroxyapatite est essentiellement
liée :
au pH
environnant,
à la concentration en ions calcium, phophates et fluor.
Dans des
conditions physiologiques (pH 7), la salive se comporte
comme une solution minéralisante.
A un
pH compris entre 4,5 et 5,5, l’émail se dissout en
profondeur ; à un pH <4,5, l’émail se désagrège
superficiellement (d’où l’apparition de lésions
carieuses rampantes lors de polycaries).
Ainsi sur la surface amélaire, se produisent des réactions
de dissolution, de précipitation et de reminéralisation au
gré des variations du pH.
Il est alors possible d’observer :
des
désintégrations restant à un niveau subclinique,
des reminéralisations totales (carie arrêtée),
l’apparition d’un leucome précarieux ou
“white spot lesion”.
La lésion carieuse est déjà présente au niveau
histologique, mais nous n’intervenons qu’au
niveau clinique ( histologique versus clinique), d’où
l’intérêt de la prévention.
Une fois la couche d’émail franchie, les bactéries
cariogènes et en particulier les lactobacilles peuvent
prospérer dans la dentine, s’attaquant à la portion
organique de la dentine (nutriment), la destruction
minérale s’effectuant en raison de la production
acide bactérienne mais également en raison de la perte de
la trame organique collagène.
1.3.
L’ ALIMENTATION : facteur extrinsèque
ALEATOIRE
Le
régime alimentaire s’envisage selon ses composantes
chimiques (sucres) et physiques (consistance).
Composition
des aliments (sucres)
Dans
l’alimentation, l’apport
glucidique nécessaire doit être de 58%
(48% de sucres complexes ou lents, 10% de sucres raffinés
ou rapides).
Parmi
les sucres cariogènes et caloriques utilisés de façon plus
ou moins constante par les micro-organismes de la plaque,
on peut citer le glucose, le saccharose, le lactose...
Parmi
les sucres de substitution (de plus en plus présents dans
les sirops à usage pédiatrique), on peut citer les polyols
d’une part : le sorbitol, le mannitol, le xylitol qui
sont non cariogènes et moins caloriques que les sucres
traditionnels et, les édulcorants intenses d’autre
part comme la saccharine, l’aspartam qui sont
acariogènes et non caloriques.
Malgré
les conseils de prévention, les sucreries ont une place de
choix dans les manifestations destinées aux enfants ; elles
sont considérées comme des signes d’affection,
d’attachement ou encore comme moyen
d’apaisement.
Consistance
des aliments
La
consistance des aliments est un facteur à prendre en
considération. Les aliments durs et fibreux favorisent la
croissance alvéolodentaire et la salivation. Une
alimentation solide peut commencer dès 18 mois.
Ainsi les
habitudes alimentaires jouent-elles un rôle considérable
sur l’incidence de la carie.
1.4.
LE TEMPS :
NEWBRUN, en 1978, ajoute
le
temps au
schéma de Keyes. Le temps est nécessaire aux bactéries pour
adhérer à l’émail ainsi que pour mettre en oeuvre
leurs différentes activités métaboliques.
A côté de ce temps bactérien, le temps intervient également
dans la fréquence de consommation en hydrates de carbone
ainsi que dans le contact sucres/dent qui seront des
éléments déterminants dans l’apparition du processus
carieux.
Ce temps de contact est influencé par :
la
qualité du sucre,
la production salivaire,
la présence d’obstacles (encombrements dentaires,
cavités carieuses, morphologies occlusales tourmentées).
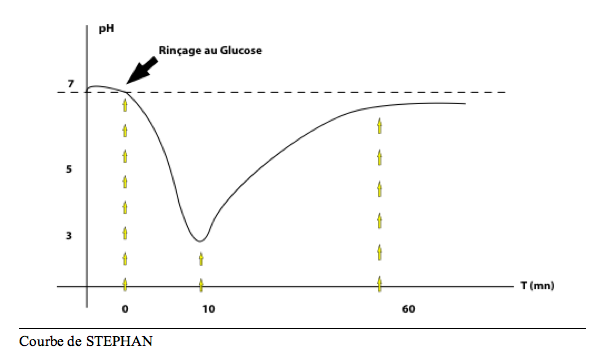
Au
vu de la courbe de Stephan, il est très compréhensible
qu’un seul apport même massif en sucre est préférable
à plusieurs, même légers dans une même journée.