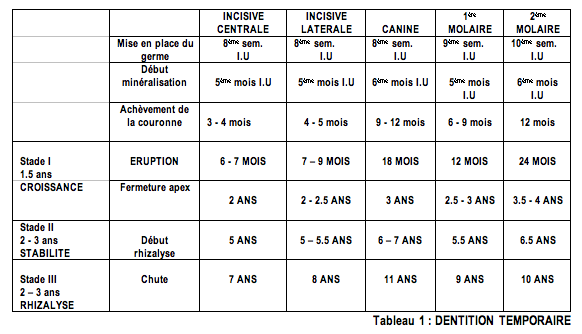2 . PHYSIOLOGIE DES DENTS TEMPORAIRES ET
DEFINITIVES
Le rôle que joue
la denture temporaire dans le développement de
l’enfant (crânio-facial, corporel et relationnel)
doit exhorter le praticien, et
a fortiori le pédodontiste,
au maintien des dents déciduales sur l’arcade
jusqu’à leur date d’exfoliation normale, suivie
de leur remplacement par les dents
définitives.
Cet objectif ne peut être atteint que par des traitements
préventifs et conservateurs appropriés dictés par une
connaissance parfaite de l’embryo-physiologie de la
dent temporaire considérée à
tort
et pendant
longtemps comme un « sous-organe »
de la dent
définitive.
2.1.MORPHOGENESE
DES DENTS TEMPORAIRES
2.1.1. Vie prénatale des dents temporaires
Les dents se forment à partir d’un bourgeon dentaire
individuel qui a une double origine : la lame
dentaire, dérivée de l’épithélium buccal et le
mésenchyme avoisinant (ectomésenchyme).
Chez l’embryon humain à la 8ème semaine, la cavité buccale est
tapissée d’un épithélium recouvrant le mésenchyme
(tissu conjonctif embryonnaire).
Sous l’action inductrice du mésenchyme, des
proliférations localisées des cellules épithéliales vont se
produire : c’est le début de la morphogenèse
primaire.
L’épithélium buccal subit un épaississement et
formera bientôt des bourrelets continus qui
s’enfoncent dans le mésenchyme pour former « le
mur plongeant » ou lame primitive. Ces bourrelets en
forme de fer à cheval sont les futures arcades dentaires.
Vers le 40ème jour, le « mur
plongeant » va se dédoubler pour donner la lame
vestibulaire et la lame dentaire qui s’infléchit en
direction linguale.
De la lame vestibulaire naîtra le sillon
vestibulaire : c’est l’amorce de la
formation du vestibule buccal.
A partir de la lame dentaire, dans chaque futur maxillaire
s’individualisent dix épaississements épithéliaux
localisés coiffés par des regroupements de cellules
mésenchymateuses : ce sont les bourgeons des dents
temporaires. Ils vont s’accroître rapidement et
auront tendance à s’isoler de la lame dentaire qui
leur a donné naissance.
A la
7-8ème
semaine, nous
serons en présence des bourgeons des incisives, des
canines. Quant aux bourgeons des dents temporaires
pluricuspidées, ils apparaissent à peu près en même temps
sur les deux lames : pour la première molaire
8-9ème
semaine, pour la
seconde, un peu plus tardivement (10-11ème
semaine).
Toujours postérieurement, nous aurons le bourgeon de la
première molaire définitive vers le 4ème
mois
in utero. Enfin, vers 1
an et 5 ans après la naissance, ceux des 2èmes et 3èmes
molaires définitives.
Chacun des bourgeons va s’enfoncer dans le mésenchyme
odontogène qui prolifère activement de sorte que le germe
dentaire sera bientôt constitué par deux éléments : la
partie épithéliale et la partie mésenchymateuse. Le
bourgeon prend alors la forme d’une cupule.
On peut alors constater un ensemble épithélial, une papille
et une enveloppe mésenchymateuse, un sac folliculaire.
La dépression cupuliforme du bourgeon
(10ème
semaine) va aller
en s’accentuant jusqu’au 3ème ou 4ème mois. Pendant toute cette
période, les germes sont au stade de « cloche
dentaire » ; le bourgeon se transforme alors en
organe de l’émail. L’histogenèse de
l’émail se précise avec la mise en place de 4 couches
cellulaires :
- L’épithélium adamantin
externe,
- Le réticulum étoilé (gelée de l’émail),
- Le stratum intermedium,
- L’épithélium adamantin interne.
2.1.2. Vie
post-natale des dents temporaires :
Nous proposons dans ce paragraphe un certain nombre de
données ; ces dernières ont été volontairement
simplifiées dans un but didactique.
Se rappeler cependant que :
- Les âges indiqués sont
susceptibles de subir des variations dans les limites de
physiologie normale, soit plus ou moins six mois pour les
dents temporaires,
- L’éruption des dents mandibulaires précède toujours
celle des dents maxillaires ;
- L’éruption des dents homologues n’est pas
toujours synchrone ;
- Le sexe, la race, la nutrition, le climat, la pathologie
interfèrent également.
L’éruption, pour l’ensemble des dents
temporaires, se situe entre l’âge de 6 mois et 2 ans
et demi, soit une poussée dentaire par semestre.
A la naissance, tous les germes temporaires sont présents
au sein des bases osseuses.
La dent temporaire a une durée de vie déterminée dans le
temps. Son existence fonctionnelle passe par trois stades
physiologiques post éruptifs :
Stade 1 : C’est une
phase de
croissance qui dure de l’éruption à
l’édification complète des racines (un an et demi
environ). A ce stade, la pulpe est à son maximum de
potentiel réparateur et dentinogène.
Stade 2 : C’est une
phase de
stabilité qui dure de l’édification
complète des racines à la résorption radiologiquement
décelable. Sur une radiographie, la fin du stade 2
correspond à la disparition de la moitié apicale de la
racine (trois ans environ). Les réactions de la pulpe sont
comparables à celle de la denture définitive. Néanmoins, la
pulpe se caractérise par une susceptibilité particulière à
l’inflammation sur un mode dégénératif.
Stade 3 : C’est une
phase de
résorption qui dure de la résorption
radiologiquement décelable à la chute précédant
l’éruption de la dent définitive (trois à quatre ans
environ). Au cours de cette phase, la dent et le parodonte
subissent d’importantes modifications relatives à la
migration apicale de l’attache épithéliale, aux
canaux pulpo-parodontaux, à la porosité du plancher
pulpaire.
2.2.
NECESSITE DE LA CADUCITE DES DENTS
TEMPORAIRES
L’existence de la dent temporaire est éphémère et
régie par cinq phénomènes génétiquement programmés :
- Organes trop petits pour une
arcade croissante et mal adaptée à l’évolution de la
fonction manducatrice,
- Ephémérité liée à la présence de la dent de remplacement
et assurée par la résorption (ostéoclastes) dentinaire,
cémentaire et osseuse,
- Brève période de maturation (un an et demi),
- Rhizalyse coïncidant avec la fin de la formation de la
couronne de la dent définitive,
- Sénescence pulpaire liée à la résorption.
2.3.
PARTICULARITES DES DENTS TEMPORAIRES
2.3.1.
Morphologie
La couronne est
globuleuse avec un étranglement cervical. Cette anatomie
particulière favorise l’apparition de lésions
septales interdentaires, de lésions carieuses proximales et
complique la prise au davier lors de
l’extraction. Ces dents étant plus fragiles,
une butée de fermeture des mors est préférable (daviers
pédodontiques spécifiques).
Les sillons de la face occlusale sont très marqués au
niveau des molaires lors de leur éruption,
c’est-à-dire lors de l’installation de la flore
buccale (physiologique et pathologique), puis les surfaces
s’abrasent par la suite.
Les racines sont effilées, en pinces sur les molaires, ce
qui occasionne fréquemment des fractures lors des
avulsions.
2.3.2.
Histo-anatomie
L’EMAIL :
- L’épaisseur
d’émail est moindre sur une dent temporaire
que sur une dent
définitive et en particulier, au niveau du 1/3 cervical des
faces proximales. A cet endroit, une usure s’effectue
favorisant l’apparition de caries jumelles.
- Il existe 2 types d’émail : l’émail pré-natal
(mieux minéralisé) séparé de l’émail post-natal par
la ligne d’Orban ; l’émail post-natal est
prépondérant dans la 2° molaire.
- Les prismes d’émail sont perpendiculaires au niveau
de la face occlusale et orientés de bas en haut au niveau
proximal ce qui entraîne une destruction de pans entiers en
cas de carie. De plus, ces prismes ont une mauvaise
coalescence.
LA DENTINE :
Son épaisseur
est moindre que celle des dents définitives sauf au niveau
des faces occlusales.
Le diamètre des tubuli important favorise la pénétration
bactérienne.
LA
PULPE :
La pulpe est
volumineuse puisqu’elle occupe le 1/8° de
l’espace coronaire (pulpe permanente 1/27°)
et ses cornes sont
très saillantes. Le volume de la pulpe et sa configuration
expliquent la fréquence des atteintes pulpaires lors de
lésions carieuses proximales en denture temporaire.
LE
CEMENT :
Le
cément est peu épais et poreux.
Le plancher de la chambre camérale est mince et traversé
par des canaux pulpo-parodontaux.
Les espaces interglobulaires de CZERMAK, sortes de lacunes
cémentaires, augmentent la porosité des structures et donc
la rapidité de diffusion de l’infection dans les
structures périphériques.
Des
contraintes anatomiques et physiologiques découlent les
formes cliniques et par là-même, les thérapeutiques.